À la fin de sa très pénétrante préface aux Poésies complètes, la traductrice, Françoise Delphy, convoque le poème 519 (écrit en 1863 : la poétesse est alors âgée de 33 ans), qui commence ainsi : « Ceci est ma lettre au Monde / Qui jamais ne m’a écrit », avant de lancer cette interrogation : « Le monde, plus d’un siècle plus tard, serait-il enfin en train de lui répondre ? »
Heureuse coïncidence, simultanément nous sont offertes la publication de la totalité des poèmes d’Emily Dickinson, en version bilingue et dans l’ordre chronologique, ainsi que la projection, sur les écrans français, du biopic de Terence Davies, Emily Dickinson. A Quiet Passion, ce dernier d’autant plus remarquable qu’il réussit une double gageure : raconter la vie d’une femme dont nous ne savons pas grand-chose, recluse volontaire dans le manoir paternel, vouée à l’unique aventure de la création artistique, dont sont restituées avec délicatesse les modalités et la signification. Il ne faut surtout pas voir en Emily une victime de la condition et de l’aliénation féminines. C’est elle qui choisit de se cloîtrer dans le domaine familial, car, déclare-t-elle en 1871, « la Société est pour moi une torture ». De ce retirement progressif du monde naît une mythologie autour de sa personne, excentrique et réfractaire à l’idée de marchander ses écrits. Capital est le poème 788 (daté de 1863, son année la plus féconde) : « La Publication – c’est la Vente aux enchères / De l’Esprit Humain […] / Mais réduire à un Prix l’Esprit Humain / Est Infâme. »
Du reste, elle ne se pose pas en martyre romantique de la création, reconnaissant qu’elle est son propre « assaillant », qui a choisi d’abdiquer. De son vivant ne paraîtront que sept poèmes, sur les quelque 1 800 écrits par elle et découverts après sa mort. Loin de tout réalisme historique, littéraire et social, l’ensemble peut se lire comme une autobiographie onirique, ensorcelante, fondée sur l’art de la suggestion et de l’évasion. Si elle a fui jusqu’à ceux qu’elle a aimés de toute son âme (lire le poème 1429), on ne s’abstiendra pas de noter quelques éléments de son immobile vagabondage.
Née en 1830 à Amherst dans le Massachusetts, elle appartient à la plus éminente famille de la ville. Père sévère et aimant, mère psychologiquement vulnérable, elle est très liée à son frère aîné, Austin, et à sa sœur cadette, Lavinia. L’époque et la région sont en proie à des mouvements de ferveur religieuse, auxquels elle résistera durant ses études. Parmi ses nombreuses lectures émergent les sœurs Brontë, Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, le couple Browning… Bientôt tout de blanc vêtue, perpétuellement et sans doute chastement amoureuse, comme sa correspondance l’atteste, elle marque une prédilection particulière pour Sue (Susan Gilbert), devenue sa belle-sœur en épousant Austin. Mais ce dernier la trompera avec Mabel Loomis Todd, laquelle contribuera à la reconnaissance posthume et à la légende d’Emily en publiant, dès 1894, un premier recueil de lettres et en participant à l’édition de sa poésie. Fragile, exaltée, dépressive, Emily meurt en 1886 de la maladie de Bright, un dysfonctionnement des reins. Dix ans avant sa mort, elle avait reçu, de la poétesse Helen Hunt Jackson, ce bouleversant témoignage : « Vous êtes un grand poète – et vous faites du tort à vos contemporains de ne pas chanter à voix haute. » Tort réparé, aujourd’hui. De ce génie incomparable, on esquissera ici la mention de quelques thèmes…
En créatrice maîtresse de ses principes, Emily Dickinson, dont la métrique est scandée par les tirets qui raturent et saturent l’espace, nous procure les clés de son art poétique, qui consiste à faire que « Se Distille un sens étonnant / À partir de Significations Ordinaires […] / C’est Lui – le Poète – / Qui Dévoile, les Images – » (poème 446).
Nantie de ce don, usant du vers et du verbe tour à tour, comme d’un microscope ou d’un télescope, elle parcourt une vaste gamme thématique, dont je retiendrai d’abord le motif de l’amour, sous quelque forme qu’elle l’ait éprouvé. On en rencontre la plus belle expression dans les références à Sue, qui traversent le temps. Sue est présente soit allusivement – ainsi, en 1863 :
« Pour le Cœur de Femme le plus Vaste que je connaisse
Je ne puis faire grand-chose –
Et pourtant le plus Vaste des Cœurs de Femme
Peut, lui aussi, être percé d’une Flèche,
C’est pourquoi, instruite par celle que j’ai au côté –
Je me tourne – plus tendrement vers elle » (poème 542) –,
soit explicitement par l’insertion du poème dans une lettre, telle que celle envoyée en 1884 : « Sois Sue, moi je suis Emily – / Et sois ensuite, ce que tu n’as cessé d’être, l’Infini – » (poème 1658).
En alternance avec ce motif de la passion se dresse la hantise de la mort, qu’elle affronte avec une foi qui oscille de l’inquiétude métaphysique à l’exaltation de la conscience : « Mourir – sans Mourir / Et vivre – sans la Vie / C’est le Miracle le plus ardu / Qu’on propose à notre Foi » (poème 1027), foi qui l’amène à une assurance sur l’« éternité » (terme récurrent, comme celui d’« immortalité ») : « Ce Monde n’est pas une conclusion » (poème 373).
Notre lecture non plus. Pour combattre la déperdition du style, aujourd’hui gravement avancée, pour lutter contre le commerce au rabais de la société marchande, je ne puis qu’inviter le candidat à la beauté à prendre des initiatives : s’offrir sa cargaison de poèmes d’Emily Dickinson ; aller voir le film de Terence Davies pour entendre réciter cette poésie absolument magique. Après quoi, gardez à votre chevet ce volume admirable et, chaque soir, goûtez ces images qui transfigurent le réel : elles sont « notre part de nuit à porter » (poème 116).
Apostille : la librairie a pour vocation de faire connaître les livres, de leur donner leur chance. C’est ainsi qu’un peu tardivement j’ai découvert et acquis l’essai de Susan Howe (née en 1937), intitulé Mon Emily Dickinson, paru aux États-Unis en 1985 et à présent disponible en français, dans la traduction d’Antoine Cazé, aux éditions Ypsilon. Je signale ici son existence, en attendant de le lire et d’en rendre compte…
Serge Koster
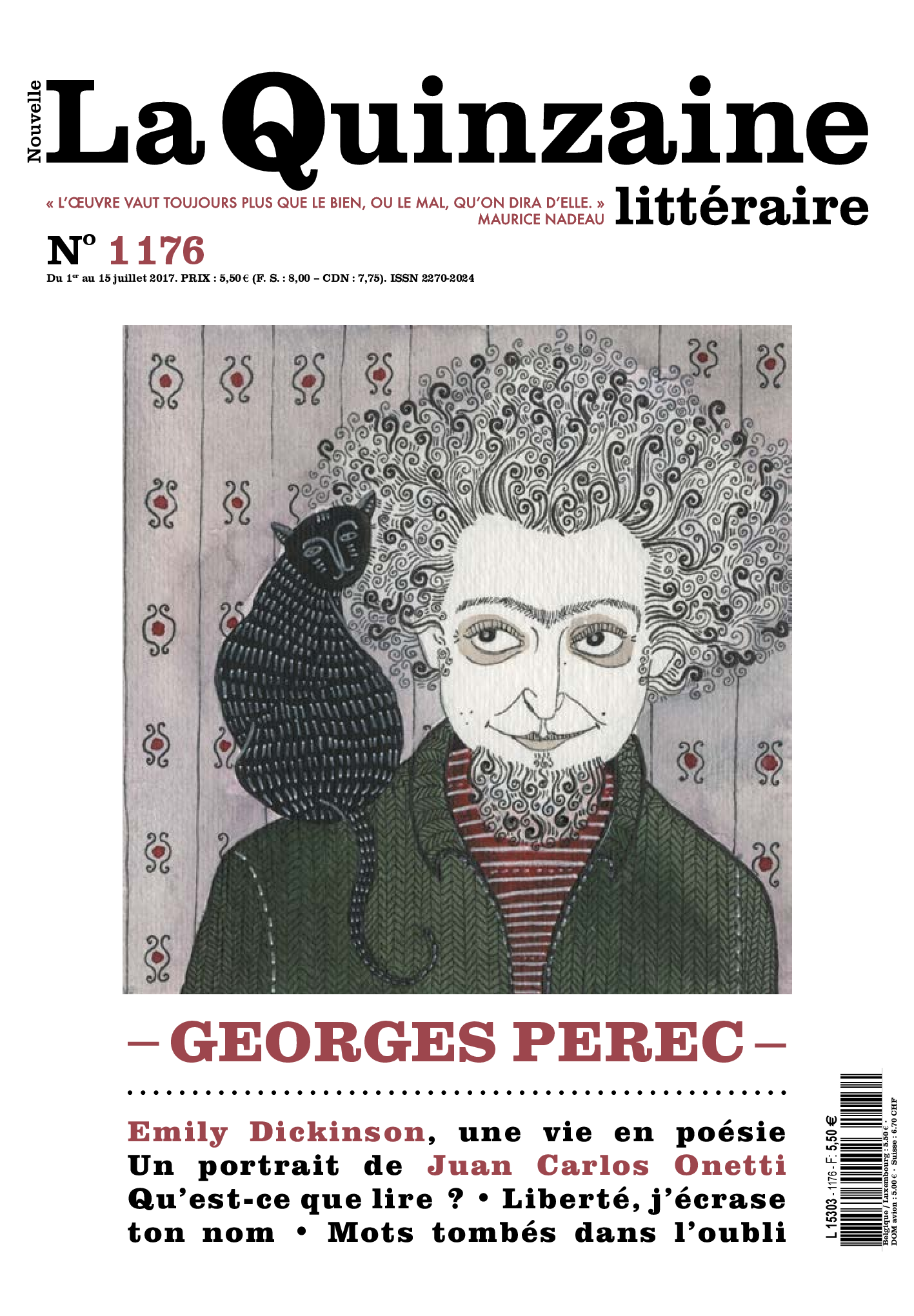

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)