Les nazis voulurent cyniquement en faire un camp de propagande et y tournent un film pour cacher l’effroyable réalité de ce camp de vieillards de femmes et d’enfants dont seuls quelques centaines survécurent, sur près de cent mille personnes. Adler lui-même y fut déporté de 1942 à 1944 puis à Auschwitz où périt sa femme. Il fut libéré en 1945 et s’occupa du sauvetage de nombreux enfants juifs et allemands. Adler est l’auteur de plusieurs autres romans dont Les Murs invisibles qui restèrent sans grand écho.
Un voyage où les lieux, mis à part peut-être Leitenberg, et les personnages sont tous fictifs décrit de façon symbolique, transposée dans une réalité imaginaire, mais d’autant plus plausible, tout l’itinéraire d’un médecin juif du nom de Lustig et de sa famille, de l’exclusion et de la déshumanisation, à la déportation et la mort. Le mot « juif » n’apparaît à aucun moment du récit, les personnages du récit sont sans appartenance apparente si ce n’est à celle du genre humain. Ce qui est particulier à ce livre, c’est qu’il semble décrire avec une foule de petits détails matériels, le déroulement devenu impersonnel et anonyme d’une famille quelconque.
Tout commence par ce nouveau commandement « Tu n’habiteras pas » et donc par la perte du lieu. Cette famille se trouve dépouillée de tout, tout est devenu à la fois incompréhensible et évident de façon infernale, irrémédiable. Le monde n’est plus qu’une somme d’interdits. Toute une première partie de ce récit décrit la façon dont geste après geste, objet après objet, tout est abandonné, perdu à jamais. Comme précisément, on ne sait rien de l’appartenance des personnages, ce genre de persécution et d’exil n’en montre que d’autant mieux, si on peut dire, à quel point un tel exil est injustifiable et monstrueux. Puis c’est le voyage ou la déportation, le passage muet des convois dans les villes. Tout est devenu atone, comme indifférent dans ce malheur fondamental. « Rien n’est suffisamment particulier pour être ou ne pas être. Seulement vous voyez les choses de différentes manières ou vous ne les voyez pas du tout. En tout cas on passe, et on vous accompagne dans ce passage. Ou bien vous vous trouvez immobiles, pétrifiés, et on fait tout glisser sur vous. »
« Mais qui sont les vivants désormais, et qui sont les morts ? »
Au cours de cet interminable voyage on voit Karoline, la femme du docteur, faire semblant de croire que le réel est encore réel, que le voyage en chemin de fer est encore un voyage en chemin de fer alors que tout est voué à la disparition : la voie n’est pas une voie réelle, construite sur des traverses feintes qui ne vont nulle part puisque tous les lieux sont des lieux d’effacement et d’anéantissement. Toute vie réelle disparaît derrière cette survie provisoire subie où plus personne ne décide de quoi que ce soit, toute existence est prise dans une gangue d’indétermination avec la mort au bout. C’est évidemment sa propre déportation vers Theresienstadt qu’Adler décrit dans ce livre à plusieurs voix, vraisemblablement très autobiographique. Les voyages vers l’inconnu, celui d’un autre personnage nommé Zerline, la cousine, mènent vers des destins évidents. La structure en est à la fois simple et très emmêlée de réflexions rétrospectives et d’interruptions de toute sorte, vaine tentative de faire comme si le monde était encore le monde. « Mais qui sont les vivants désormais, et qui sont les morts ? » s’interroge-t-il.
Paul, le personnage principal, survit et devient ce qu’on appelait à l’époque une DP, une displaced person, quelqu’un qui désormais privé de nationalité et d’appartenance ne cesse de vivre sous le poids de ce qui lui est arrivé.
Un voyage est un exemple de ce que la survie à la déportation rend toute démarche de « retour » ou d’intégration, à la fois incompréhensible pour le monde administratif environnant et infranchissable. Il n’y a plus d’issues, les noms ne veulent plus rien dire, tout vous tombe des mains ; la composition même du livre témoigne d’un désarroi irrémédiable. Adler écrit un allemand étrange, à la fois plein de tournures toutes faites et d’audaces d’expression comme pris entre la langue de Musil et celle de Doderer, une sorte de langue perdue. La traduction restitue bien ce mélange de désespoir et d’impossible retour à une langue d’avant.
Le récit est suivi d’une importante postface du fils d’Adler, Jeremy, qui a pour titre une phrase d’Adler « Seul qui ose le voyage trouve le chemin du retour ». Il montre toutes les difficultés qu’eut son père à se faire entendre, exposé qu’il était à l’incompréhension dans ces lendemains où on voulait tout oublier.
Georges-Arthur Goldschmidt
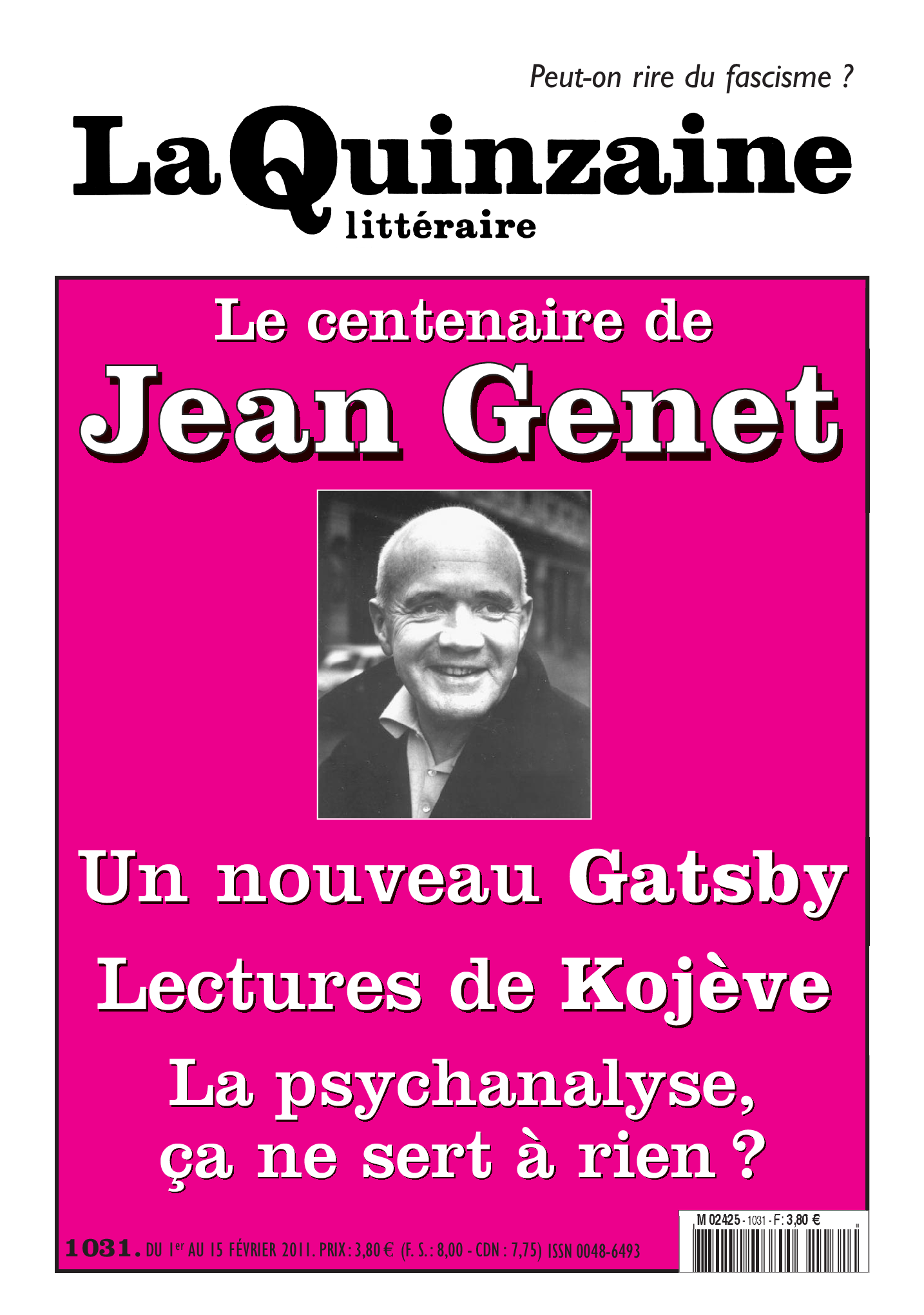

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)