Après sa lente et pénible adaptation à une nouvelle vie (1) – apprivoisement d’une autre langue et d’une culture différente – le jeune Bubi s’est tant bien que mal habitué à son existence appauvrie dans les quartiers populaires de Ljubljana. Entre l’école où il s’ennuie ferme parce qu’il ne maîtrise pas bien la langue slovène et que son accent germanique prononcé le différencie des autres, le logis misérable où ses parents travaillent, et les menus larcins qu’il commet avec ses copains alors que l’occupation italienne se fait de plus en plus dure, il vivote, gamin à demi perdu qui erre dans les rues de la ville. C’est là que le grand changement de sa vie va se produire, le confrontant au monde terrible des adultes. Il s’insurge : « Si c’est ainsi que doivent vivre les adultes, alors je préfère ne jamais devenir grand… »
Le roman se fait à la fois aventure des insignifiants et des humbles en même temps que le récit du trouble de l’identité qui envahit un garçon de treize ans qui découvre les vraies couleurs de la vie. Alors qu’il survit au jour le jour dans une ville oppressante, Bubi s’initie à la sexualité, le « plus grand secret entre un homme et une femme », avec la jeune Tatiana, gamine peu farouche qui l’adore. Kovaˇciˇc excelle à nous plonger au cœur des ambiguïtés enfantines, à retrouver les émotions qui l’animèrent alors, cette manière d’ivresse éphémère que teinte une pointe de dégoût viscéral. C’est à la fois cru et d’une extrême pudeur, comme les sentiments adolescents, entre sordidité de l’envie et idéalisation de sa propre existence, entre l’enfance qui se défait comme de la peinture qui s’écaille et la vie future qui s’ordonne déjà. Les désirs les plus irrépressibles se mêlent d’une joyeuseté de jeux, le sexe se joint aux histoires que les enfants inventent pour s’échapper du réel, l’affrontant avec une forme d’innocence préservée. Combien de temps durera-t-elle ? Sans doute jusqu’au grand passage que ce volume met en scène, ce pas fait hors de l’enfance pour être quelqu’un.
Le trouble de l’adolescence, la ferveur d’être et la souffrance de se découvrir autrement que ce que l’on croyait être. Le deuxième volume de cette trilogie s’apparente à une initiation fulgurante au « monde des grands », une recherche de sa propre identité au cœur même de la guerre. Le jeune Bubi se confronte à la grandeur trouble du monde, à la violence flagrante et totale après celle, plus sourde, d’un quotidien que conforme l’inadaptation. Il s’est fait à sa nouvelle vie en Slovénie, s’est attaché malgré l’âpreté de la vie, aux lieux, aux gens, à l’étrange espace de liberté qu’il a conquis à l’écart, en mentant beaucoup, se dissimulant, s’enivrant des possibles qu’il pressent et qui le portent comme au-delà de lui-même. Entre les restrictions de plus en plus terribles, les tensions entre les occupants et la population, il observe l’Histoire en marche sans la comprendre vraiment (2), s’émancipant peu à peu de son quotidien, s’échappant de son milieu, conquérant un espace propre formé d’images et de mots, nourri de l’enivrement de la fiction et des possibles de la langue.
Devant les doutes qu’instille l’initiation précoce aux choses de la chair, il se réfugie dans un questionnement sur lui-même, sur ce qu’il sait ou ne sait pas, sur l’enchantement de la création. Nourri d’un dégoût profond pour l’école où il ne fait que souffrir (excepté lors de sa relation magnifique avec Mme Komar, son professeur de slovène), il commence par dessiner et écrire quelques histoires qui amusent son entourage, puis, au gré de rencontres surprenantes avec des artistes, il découvre la richesse de l’émotion littéraire, la puissance des textes, l’enivrement des mots et des sons. Il lit pêle-mêle Dostoïevski, Claudel, Tolstoï, les grands auteurs slovènes. Il s’enrichit et s’interroge sur le sens de la langue, sur la part qu’elle occupe dans sa personnalité et sa perception du monde. Et lorsque que son père meurt de la tuberculose, son monde s’effondre pour partie, lui enjoignant d’en augmenter le cœur, de donner un sens plus profond à ce qu’il est, à regagner en quelque sorte cette part perdue. Ainsi, il grandit en lisant, en écrivant.
La découverte de cet autre monde provoque chez lui un grand bouleversement. « À l’instant même où je décidais d’écrire, j’avais l’impression que je venais juste de m’éveiller à la vie et à la conscience, de remarquer que j’étais entouré de gens et de choses, et si je regardais très attentivement le ciel ou même le mur ou le sol ou ma main qui écrivait ou n’écrivait pas, j’avais parfois le sentiment de les découvrir. » Il ajoute, s’interrogeant sur le nœud de son travail : « en slovène, je ne peux pas décrire ce qui s’est réellement passé… il y a une réalité, mais ce que j’écris en slovène en est une autre… (…) il me semble quand je lis des livres que notre langue n’a pas assez de mots ». Et conclut, comme en un ultime regret : « J’aurais voulu que cette langue ne soit pas une torture pour moi mais un bonheur sinon même une jouissance. » Et c’est finalement dans l’écart entre sa langue maternelle, l’allemand, et celle dans laquelle il survit et existe, le slovène, dans l’opposition qui semble insurmontable entre « ces deux langues [qui] ne s’aiment pas », qu’il élabore une œuvre rare, profonde et essentielle. Le rêve de Kovaˇciˇc se réalise ainsi, par une alchimie mystérieuse, par le biais d’une tension formidable qui le fait écrire, lui donnant les outils qui forgent un langage à la fois prosaïque et illuminé, profondément vrai, honnête, paradoxalement sûr de lui-même. Le jeune Bubi se lance sur le sentier de l’écriture comme l’on s’égare ou se retrouve, Kovaˇciˇc, refaisant à l’inverse de ses premiers textes d’adolescence le parcours de son enfance terrible, revit, à distance, le cœur même de sa vie, les moments où sa vie bascule et où tout se joue. Et c’est sans doute cela, être écrivain « parler [une langue] avec joie jusqu’à sa mort ».
1. Pour mieux saisir les événements ainsi que les thèmes et la dynamique à l’œuvre dans le premier volume, nous renvoyons à notre article paru dans le n° 981 de La Quinzaine littéraire.
2. Le rapport que le narrateur entretient avec l’Histoire est d’une grande complexité, il serait trop long ici de développer, mais il constitue l’un des fondements de l’entreprise autobiographique de Kovaˇciˇc.

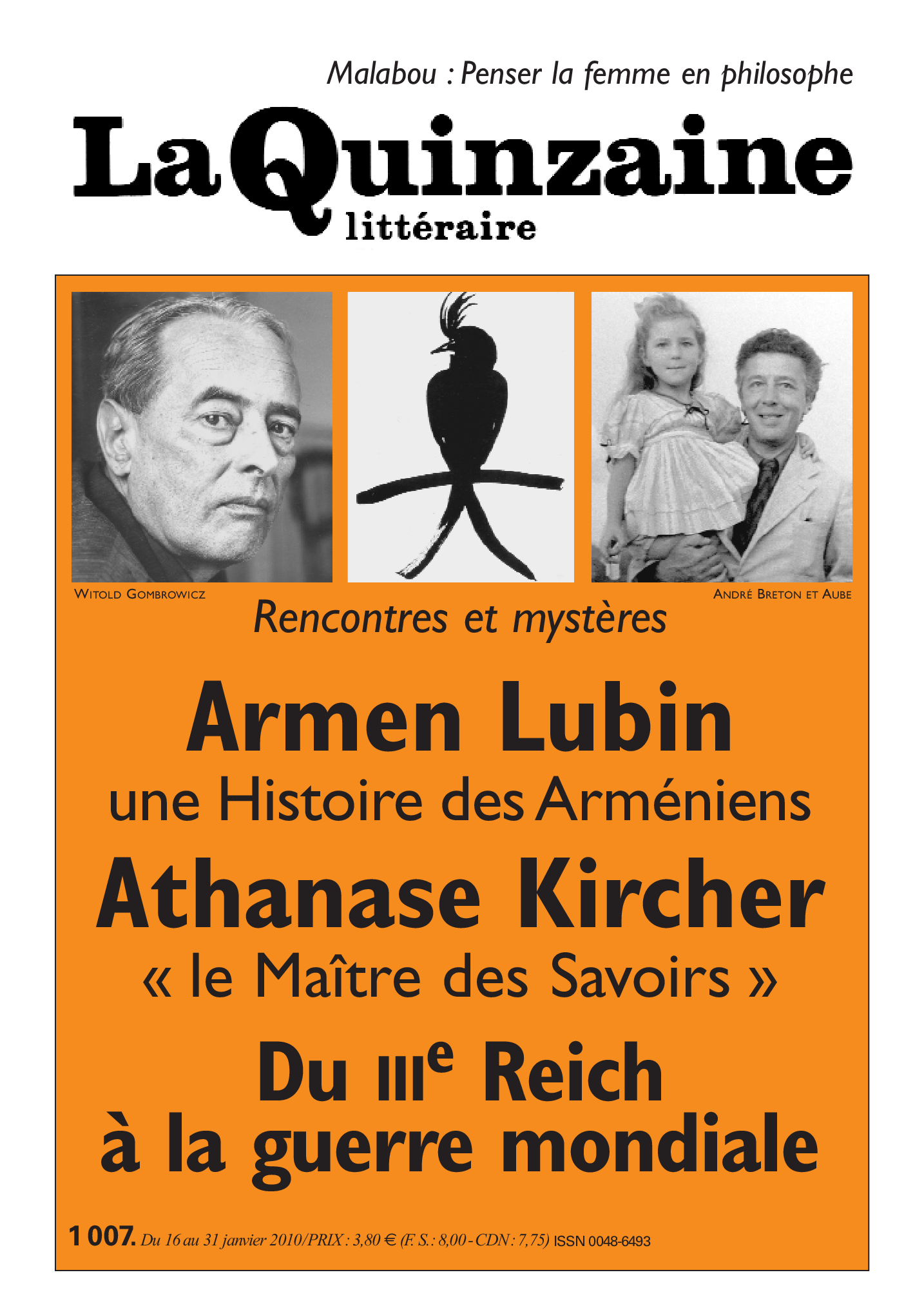

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)