Certains livres nous transportent dans un univers parfaitement inconnu, à l’autre bout du monde, nous plongeant au cœur d’une société régie par des règles différentes, primitives et sophistiquées à la fois. Entre des mœurs qui nous paraissent absconses et la vitalité d’une culture complexe, Nuit nous entraîne, sous les dehors d’un conte où la voix joue un rôle primordial – manière d’archétype sociétal et moral, représentation exemplaire –, au cœur même d’un monde du lointain, mystérieux et impénétrable. Le roman de Tchulpân entreprend un étrange paradoxe, celui de brosser le portrait précis d’une société traditionnelle, usant d’une sorte de voix de l’ancestralité, tout en s’appuyant sur une pensée nouvelle afin de procéder à un émouvant éloge du changement.
À la manière d’un récit populaire qui reprend à son compte les codes d’une culture entreprise par différentes influences – entre monde musulman, domination russe et influence chinoise –, le roman se fait à la fois réceptacle d’une tradition menacée et creuset pour l’émergence d’une modernité particulière qui entremêle des valeurs venues d’Occident et une structure sociétale où l’islam occupe une place essentielle (1). Ainsi, le roman se construit autour d’une intrigue typique de harem s’imbriquant dans un questionnement sur la colonisation et la domination étrangère. Entre sentimentalité et politique, Tchulpân écrit le roman de toutes les tensions, de ce qui sera l’objet à la fois d’une critique et d’une défense. Ainsi, nous découvrons, peu avant la Révolution d’octobre, la vie de la jeune Zebi, fille d’un derviche autoritaire que l’on marie de force à un mingbochi (2) vieillissant et dépravé, les jeux de pouvoir et les complots ourdis par les femmes pour s’évincer les unes les autres. « Et c’est un fait que celles qui vivent dans ce monde étriqué, dans cette société entravée, cette “zone interdite” […] dans une situation plus humiliante pour la femme que l’esclavage lui-même, on verra comment, poussée par la nécessité, celle-ci peut se montrer experte en subterfuges. » Ce récit de l’asservissement de la femme se déroule en parallèle du parcours d’un fascinant conseiller politique et commerçant retors qui tombe amoureux d’une prostituée russe, l’enlève et se conforme à la pensée nouvelle des « Modernes », ces « éveilleurs de conscience ». Le roman tisse ensemble, comme une pièce d’étoffe, ces deux histoires qui se rejoignent et se séparent pour former à la fois une intrigue intime et une fable politique.
Au travers de l’analyse des déboires d’une jeune femme confrontée à un immuable destin, à son rejet premier d’une tradition qui l’empêche de vivre son amour et qui l’enferme dans une terrifiante répétition, Tchulpân s’interroge autant sur la condition de la femme, sur le lien difficile qui unit un être à son milieu, que sur les nécessaires évolutions que la société doit emprunter, sur les mouvements réformateurs et traditionalistes qui la travaillent en profondeur. Il devient de fait l’un des chantres du djadidisme et propose une vision équilibrée de la société, empruntant à l’Occident un certain nombre de principes tout en refondant une pensée arabe et islamique mise à mal par les occupations successives du pays. Il défend une position très clairement anti-coloniale, affermissant les principes de sa culture tout en en entrevoyant une société plus ouverte. Le livre entrecroise ainsi une grande variété d’aspects, faisant converger, au travers d’une langue prosaïque et imagée, souvent proverbiale, archaïque et novatrice dans un même élan, une intrigue amoureuse classique, un questionnement politique, une fresque historique ambitieuse et une manière de poétique de la résistance. Le roman apparaît mobile, changeant, d’une souplesse fascinante, jeu de formes et de codes qui s’agrègent pour donner un rythme inimitable au récit, en équilibre entre l’immuable et le changeant. C’est l’ironie qui fait tenir tout ceci ensemble, contrebalançant tous les propos, rééquilibrant tous les excès, faisant de tout une manière de jeu de la pensée au centre de l’entreprise littéraire, réajustant ensemble les formes mouvantes du livre et les ambitions du romancier.
Le paradoxe de l’œuvre de Tchulpân réside dans la tension continue qui s’exerce entre l’oppression coloniale dont on rêve de se libérer, l’impression d’y parvenir, et la répétition traumatique d’un schéma de domination d’une société par un corps étranger, le corps russe. Alors que la chute du régime tsariste semble l’occasion de se défaire du joug colonial, le pouvoir bolchevik renforce le contrôle brutal sur cette « province » et s’attache à détruire systématiquement tous les éléments de particularisme culturel. C’est sans doute pourquoi le récit de Tchulpân fut reçu comme une provocation anti-révolutionnaire (3). Après vingt années d’expérience du communisme soviétique, ce dernier ose mettre en relief sa culture, se fait l’écho d’une tradition, de son ancrage profond, de la subtilité de rapports sociaux régis par des codes ancestraux souvent archaïques, d’une vie différente. Il se fait le chantre d’un ailleurs intolérable, d’une pensée qu’il faut empêcher. Comme toutes les voix dissidentes, il faut le réduire au silence, prescrire l’oubli. Mais il est impossible de le faire sûrement, ces voix ressurgissent toujours de la nuit profonde où elles furent confinées et rappellent l’essentiel, l’irréductibilité de l’être. Visionnaire ou simplement lucide, Tchulpân écrit : « En un mot, ce grand navire… ce grand et majestueux navire qui a pour nom “Empire” se dirige, au milieu de terrifiantes vagues, vers les abysses de la tyrannie et de l’ignorance, vers son propre anéantissement… »
1. Le traducteur, chercheur au CNRS, explique bien cette tension ; il est spécialiste de l’islam en Asie centrale et s’intéresse particulièrement à ses réformes dans cette région. Il définit clairement aussi le mouvement djadidiste.
2. Un potentat local soutenu par les autorités tsaristes.
3. Le roman est interdit dès sa publication en 1936, son auteur déporté, puis exécuté dans un camp en 1938. Il a fallu attendre l’écroulement de l’URSS pour que le texte regagne sa place dans la littérature nationale. La traduction française de Stéphane A. Dudoignon est la première (donc importante) dans une langue occidentale.

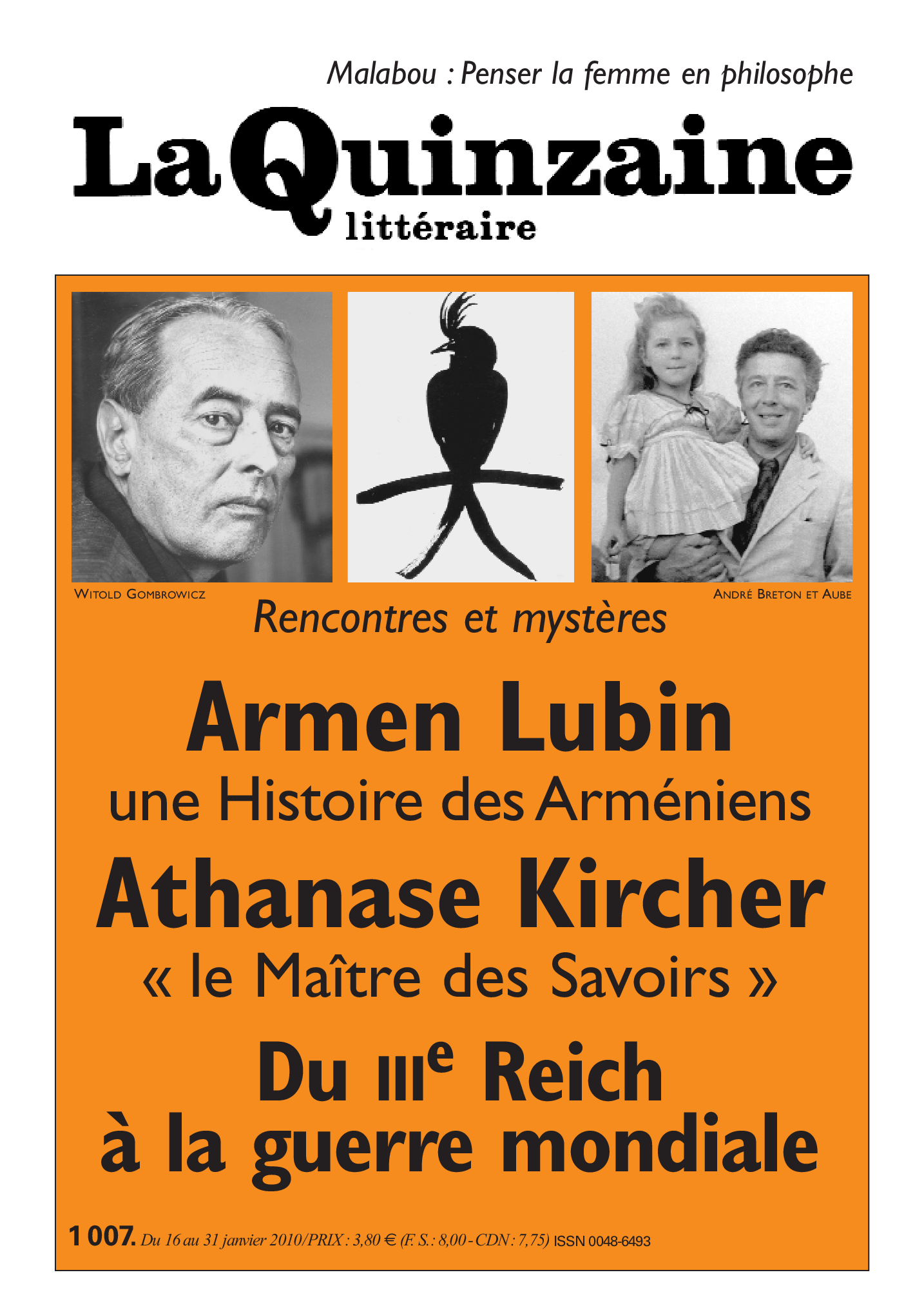

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)