Dépaysant parce que la plus grande partie du récit se passe dans un petit village de Sardaigne qui semble hors du monde et du temps. Un petit nombre d’habitants y vit difficilement de la terre. Anna Teresa Listru, veuve d’un homme qui a tout juste été bon à lui faire quatre filles avant de mourir écrasé dans le pressoir, « a quitté la pauvreté pour la misère ». Bonaria Urrai, à l’inverse, est fille de notable, elle a du bien et pourrait ne pas travailler. La soixantaine, veuve d’un fiancé qui n’est jamais revenu de la guerre, elle s’occupe en étant couturière. Et un beau matin elle se rend chez Anna Teresa, parle longuement avec elle sous le citronnier, et repart en donnant la main à Marieda, la quatrième, l’enfant non désirée, la bouche de trop à nourrir ; dans l’autre main elle porte « un cabas rempli d’œufs frais et de persil, misérable viatique de remerciement ». Tout se passe très simplement Maria devient sans heurts ni déchirements la « fille d’âme » : (« C’est ainsi qu’on appelle les enfants doublement engendrés, de la pauvreté d’une femme et de la stérilité d’une autre ») de Tzia Bonaria, sans cesser pour autant de rendre visite à sa famille d’origine. Le premier chapitre est un chef-d’œuvre de délicatesse : la romancière pénètre avec lucidité dans l’âme naïve d’une petite fille de six ans, intelligente et sensible, et dans celle de la nouvelle mère, pleine de pudeur et de tact. Sans le moindre discours pour rassurer l’enfant un peu effarouchée : « Elle se contenta d’attendre que la maison eut peu à peu épousé la forme de la petite, et quand, un mois plus tard, Maria eut définitivement ouvert toutes les portes, elle eut la sensation qu’elle ne s’était pas trompée. » On voit que le style, très bien rendu par la traductrice, est en parfaite harmonie avec la simplicité du récit.
Le rapport qui s’établit entre les deux femmes ne sort jamais de ce registre. Pas la moindre banalité, jamais rien d’inutile. Tout est poésie naturelle, fût-elle un peu rude. Maria grandit, travaille bien à l’école, mais un soir elle s’étonne de ce que la Tzia soit partie en voiture avec un homme, sans vouloir lui donner d’explication. Cinq années passeront avant que cet étrange comportement ne se reproduise et ne réveille les questionnements de Maria. Avec beaucoup d’habileté la romancière révèle enfin ce qu’est la très ancienne (et, paraît-il toujours en vigueur) pratique de l’accabadora. Une pratique qui ne se fait pas à la légère, et que très rarement, comme on le voit. Maria commence à comprendre, mais refuse de croire à ce qu’elle pressent.
Heureusement il n’y a pas que des enterrements dans le petit village, il y a les vendanges, les fêtes, les mariages, celui de la sœur aînée de Marieda, par exemple. Autant d’occasions de replonger dans des rites très anciens. Il y a aussi les amourettes des filles qui grandissent. Malheureusement c’est par son timide soupirant que Marieda apprend ce que fait Tzia Bonaria au cours de ses mystérieuses absences. Horrifiée, sans chercher à comprendre, elle quitte le jour même sa bienfaitrice et trouve une place de gouvernante dans une famille turinoise. Là aussi tout se passe simplement, jusqu’au jour… où tout finit mal. De toute manière Marieda serait retournée au village car sa mère adoptive est gravement malade. Sa très douloureuse agonie, assistée par une Marieda pleine de dévouement, durera de longs mois, et la jeune fille comprendra enfin pourquoi l’accabadora lui avait murmuré, comme une justification : « Ne dis jamais fontaine je ne boirai pas de ton eau. »
Le livre tourne donc autour de trois idées maîtresses : l’adoption, l’euthanasie et le droit de juger. Sans être un roman à thèse, le récit n’est donc pas pur récit. Mais c’est la poésie qui imprègne les actes les plus quotidiens, les plus noirs comme les plus lumineux, qui en fait la valeur. L’autre mérite du roman étant de sauver une parcelle de tradition qui n’existera bientôt plus que dans les livres, si ce n’est sur des supports plus fragiles encore. L’épisode de la couronne de pain des mariés en est un savoureux exemple : « Marieda n’ignorait pas que ce cercle de pâte cuite, destiné à l’offertoire puis à l’éternité d’une vitrine (…), avait plus d’importance que leurs alliances. C’est même la raison pour laquelle elle le souleva avec grand soin pour le poser lentement sur sa tête. On eut dit qu’il avait été fait à ses mesures. Dans le miroir Maria se vit enfin belle, une reine de pain révérée par l’odeur d’interdit de ce couronnement silencieux. Elle sourit. Soudain un bruit de pas la fit sursauter (…) elle réagit trop tard pour éviter le désastre : le pain de bon augure s’écrasa au sol dans un bruit sec d’os brisés, perdu. »
Il s’agit bien là d’une poésie hors du temps, donc de tous les temps.
Monique Baccelli
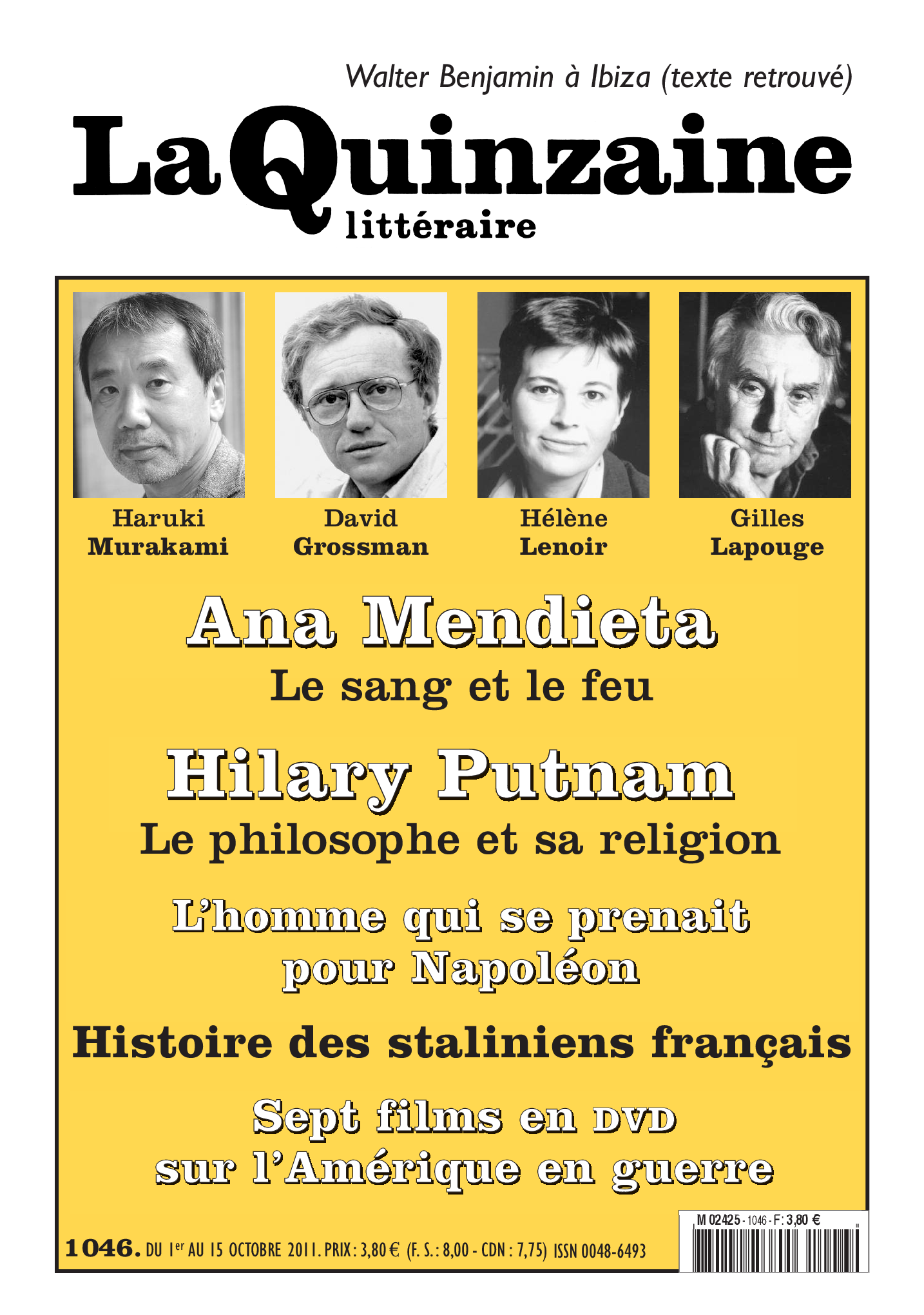

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)