Quarante et un, c’est le nombre de sonnets que publie l’auteur pour retracer les huit dernières années de la vie de sa mère, installée dans une maison de retraite, c’est-à-dire dans ce qu’il faut bien appeler une « antichambre de la mort », quelque part dans le Cantal sans doute, là où il est né. Le fils qui habite maintenant à Autun lui rend régulièrement visite et ne peut qu’enregistrer les progrès, si c’est le terme qu’il faut employer, de cet affaiblissement surtout psychologique mais dont on voit aussi les ravages sur les corps : « Ils sont en cercle dans la salle commune, / sur des fauteuils, ou bien des fauteuils roulants, // ou alignés sur des chaises le long d’un mur, / menton sur la poitrine pour la plupart. » Le ton reste mesuré, Jacques Lèvre évite l’indignation facile comme les mots crus, trop brutaux, trop sordides, pour décrire la réalité de ces endroits où les personnes âgées sont « parquées » (le mot est de lui, qui revient plusieurs fois au fil du texte). Les visages changent, bien sûr, un pensionnaire décédé est rapidement remplacé par un autre, mais les postures demeurent les mêmes, et les images de mentons inclinés, de fauteuils, roulants ou non, reviennent dans le texte, doucement insistantes et sans autre commentaire.
Le personnel médical, pourtant si souvent admirable dans ces lieux difficiles, n’est pratiquement pas mentionné ici : ce sont de vagues « on », des « employées en blouse blanche », des noms qui restent communs et de toute façon rares. Le poème préfère se concentrer sur la relation de la mère et de son fils. Les sonnets se succèdent selon une chronologie rigoureusement établie, l’âge de la vieille dame étant fréquemment rappelé au fur et à mesure de l’avancée de notre lecture et des visites du poète. On le sait, la façon dont passe le temps dans ce genre d’endroit est particulière : « Tous ces vieillards […] qui semblent ne plus rien attendre – sinon la mort », note-t-il. Constatant combien ces « vieillards » aiment à rappeler leurs plus anciens souvenirs, il émet même l’hypothèse que c’est parce que ce qui les attend n’est que trop certain qu’ils inversent ainsi, dans les confusions muettement douloureuses pour leur entourage, la flèche du temps, remontant couramment à leur jeunesse, à leur enfance. Et si Jacques Lèbre rappelle le mot bien connu de Chateaubriand, « la vieillesse est un naufrage », c’est pour s’exclamer aussitôt que ce « naufrage est d’une incroyable lenteur ! »
En égrenant les années, l’auteur permet à son lecteur de suivre comme lui l’évolution de la dégradation de l’état de santé de celle qui lui a donné le jour. Entrer dans ce genre d’endroits, c’est d’abord ne plus penser aux courses, à la cuisine, au ménage, à tous ces gestes du quotidien qui font que « les neurones / fonctionnent ». Puis c’est l’oubli du nom des gens, des lieux, les difficultés croissantes à se déplacer, la crainte de la mauvaise chute, la confusion des époques, donc, et des jours de la semaine, l’attente de la fin en regardant par la fenêtre où rien ne se passe ni même ne passe. Ce que l’écrivain dit de sa mère, il pourrait le dire de beaucoup d’autres résidents de l’établissement car ceux-là adoptent très fréquemment les mêmes habitudes et les mêmes comportements, leur arrivée le matin dans la salle commune, leur désœuvrement avant le repas, leur façon de se tenir « en rang d’oignon », alignés sur leurs chaises, dans un couloir, dans une sorte de mimétisme qui n’est même pas du grégarisme. Car ce qui frappe peut-être le plus l’homme de lettres est le fait qu’ils « ne s’adressent pas la parole », restent « silencieux, silencieuse »… Ni eux ni sa mère, aucun ne noue de véritables conversations avec ses voisins. Devant cet état de fait, il arrive que Jacques Lèbre s’interroge : « Pourquoi ne parlaient-ils pas entre eux ? Ma mère l’avait dit, avec mépris : « Il n’y a que des vieux ! » avant d’ajouter, désabusé : « ce doit être / la même chose pour chaque nouvel arrivant. »
Si le titre insiste sur le fait que ces poèmes sont des sonnets, c’est parce que cette forme relativement brève convient bien à celui qui veut, dans un élan de dignité qui force le respect, contenir ses émotions. Il pourrait se scandaliser contre cette limitation des capacités qu’est l’enfermement dans une maison de retraite dont on sort de moins en moins, il ne le fait pas. Il n’entend pas plus développer, argumenter, exprimer une indignation ou une désolation qu’il ne souhaite souligner son propos de figures de style peu ou prou flamboyantes. À peine repère-t-on ici ou là une allitération, quelques images… Au contraire, Jacques Lèbre fait montre d’un vrai goût pour le terme juste et usuel, sans éclat, qui nous livre une expérience commune mais qui sonne juste. Les mots choisis résonnent étrangement pourtant dans le silence de ses visites. C’est que les paroles, les dialogues (certains de ces sonnets ne sont pratiquement composés que des propos de son interlocutrice) sont enserrés de non-dits, d’interdits, de questions qu’on ne peut pas poser à celle à qui on doit la vie, de conversations que l’on regrette de ne pas avoir eues avec elle. D’autres strophes sont des interrogations sur ce que l’auteur pense lire sur le visage de la vieille femme. De quoi se souvient-elle ? Son esprit n’est-il pas en train de vagabonder bien loin alors qu’il est en face d’elle ? Ne se trompe-t-il pas sur la signification de telle ombre ou de telle expression qui passe sur son visage ? L’auteur ici manque de certitude, il n’est pas toujours sûr des réponses qu’il (se) donne. Sa probité va même jusqu’à lui faire douter, parfois, de la vérité de ce qu’il écrit…
S’il poursuit, c’est peut-être parce qu’il est taraudé par une culpabilité sans doute excessive : « Cela relève d’un abandon, pourquoi ne pas le dire, / même s’il est le fait des conditions modernes de l’existence, / éloignement des enfants qui tous vivent ailleurs, / appartements qui ne permettent pas de les prendre chez soi. » Et dans cet ouvrage économe d’effets rhétoriques, une homophonie possible, reprise en plusieurs endroits, tinte étrangement aux oreilles du lecteur : « Tous [les pensionnaires de la maison de retraite], ils deviennent / des marionnettes sans fils, ces fils qui nous relient / les uns aux autres dans le courant de la vie / et qui maintiennent les neurones en éveil ». Les fils de ces marionnettes, ce sont aussi les enfants de ces personnes âgées, son frère et lui par exemple, qui ne peuvent leur parler quotidiennement, les solliciter fréquemment et donc activer leurs neurones autant qu’il le faudrait. Il faut lire ces quarante et un sonnets conçus, rédigés dans une langue simple que sa mère aurait pu comprendre comme une ultime tentative pour nouer un contact et même échanger avec elle. C’est ce qui fait la force sobre de ce texte et c’est ce qui nous laisse sans voix.
Dans le volume, ces sonnets sont précédés par le non moins douloureux « Onze propositions pour un vertige », publié auparavant en plaquette (Le phare du cousseix, 2013). Sur chaque page, les vers y sont encore plus rares que pour les poèmes de la partie centrale. L’écrivain rend compte de l’avancée d’une maladie neuro-dégénérative chez un homme, un de ses amis, un lettré manifestement qui rencontra René Char en son temps et qui se rend compte, tout du moins dans les premiers temps, de l’évolution de son mal. Ses souvenirs l’abandonnent, il craint de ne plus se rappeler le code de sa carte de crédit ou de son entrée d’immeuble. Il oublie l’heure, il erre dans les couloirs d’un hôpital, la panique passe dans son regard… « chez un être privé de tous ses souvenirs, / il n’y a plus de lieu pour le refuge » observe l’écrivain, submergé bien qu’il ne l’avoue pas, par cette tristesse que l’on retrouvera quand il évoquera sa mère. Par pudeur, Jacques Lèbre ne donne pas le nom de son camarade, mais le lecteur n’est pas prêt d’oublier cette petite suite aussi laconique que terriblement poignante.
L’ouvrage se clôt cependant sur un court ensemble de cinq poèmes, « L’amour est comme le sol » qui réaffirme salutairement, opportunément après les textes précédents, la confiance qu’il faut garder en la félicité fragile, éphémère certes, mais réelle de l’enfance – l’enfance avant la vie adulte, avant la mort à l’œuvre, comme il le rappelle dans les derniers mots du livre : « L’amour est comme le sol / qui écorchait, lorsqu’on le rencontrait, en tombant ».
Thierry Romagné
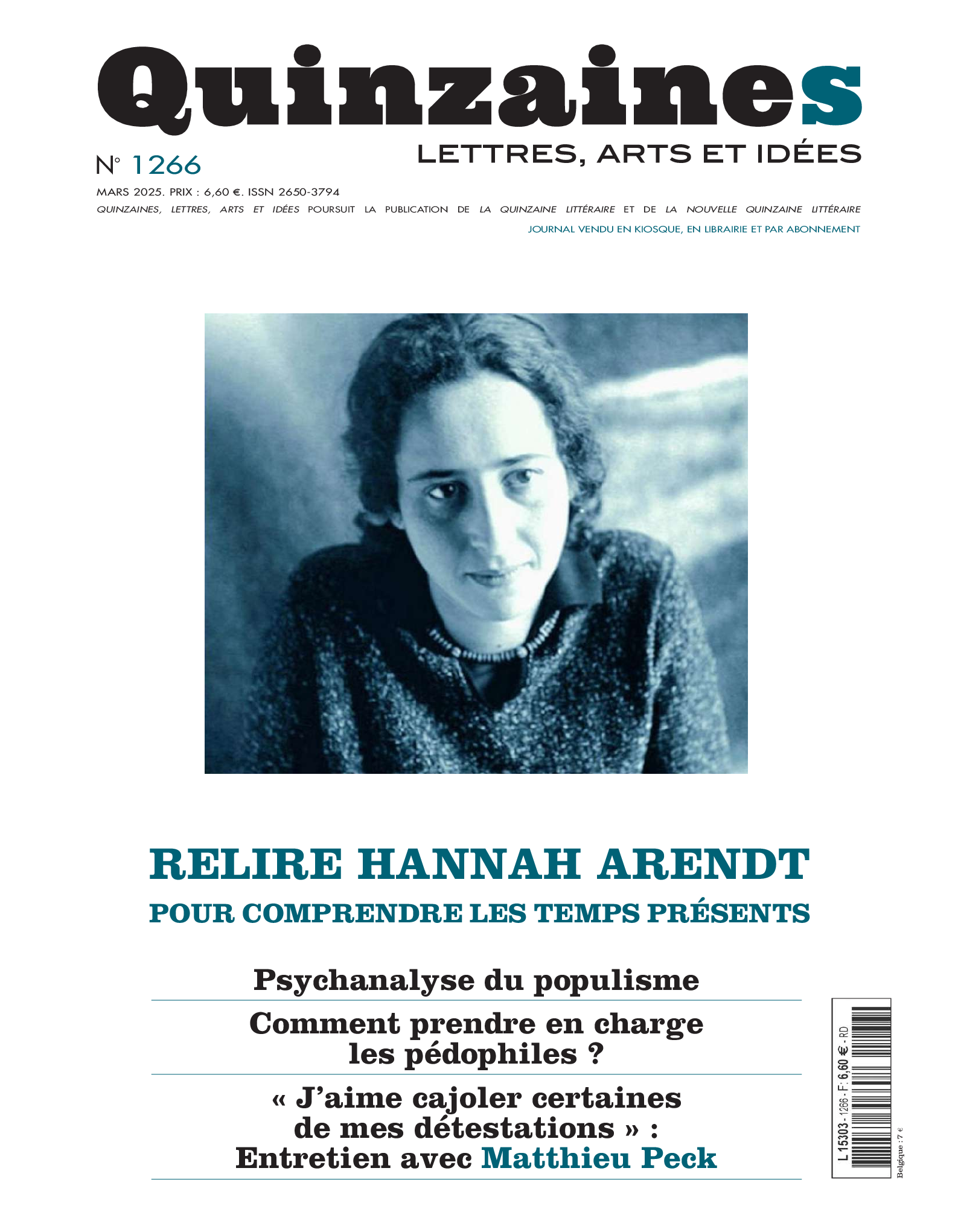
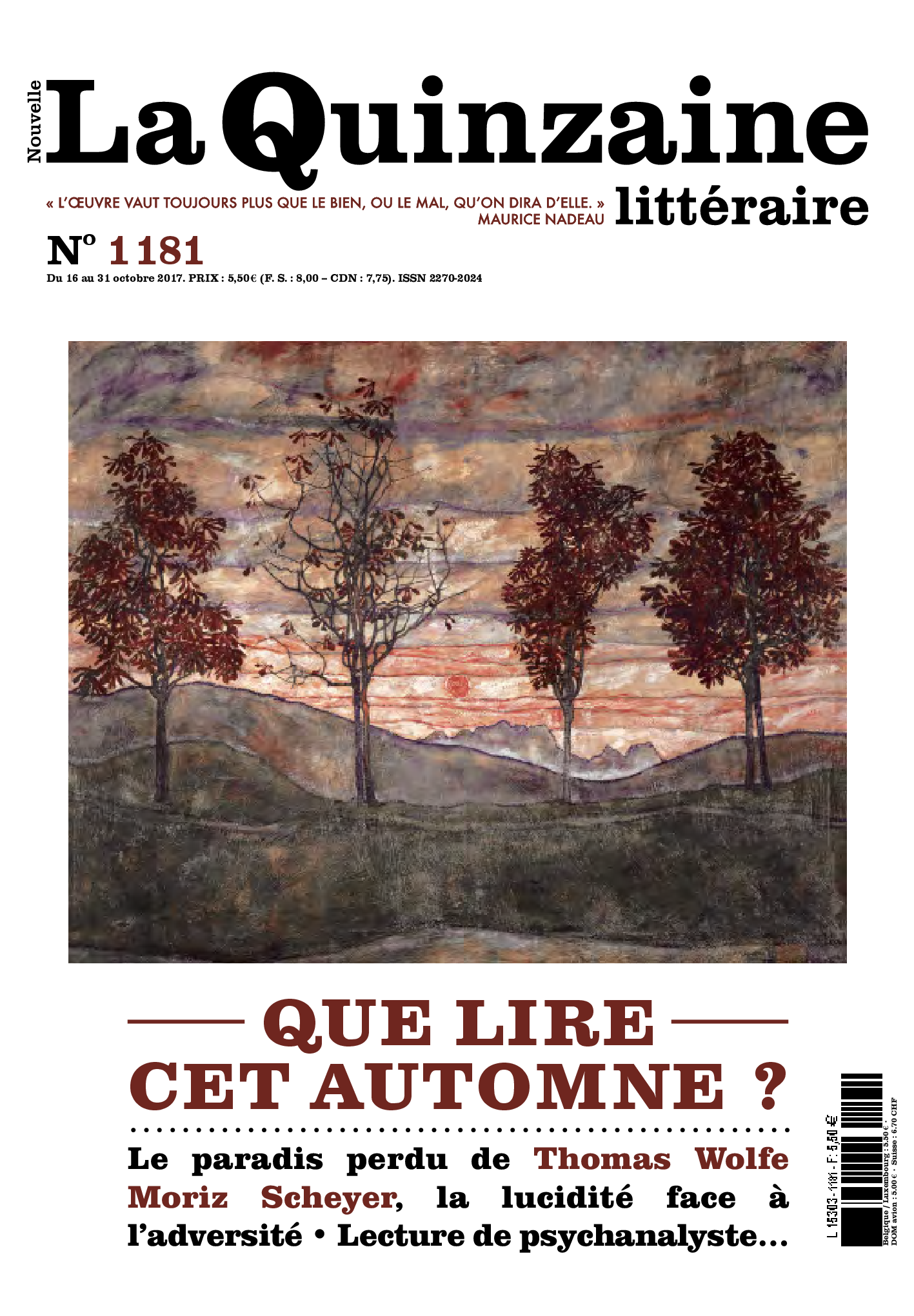
Commentaires (identifiez-vous pour commenter)