C’est entendu : de prime abord le nouvel ouvrage de Tanguy Viel est on ne peut plus imprégné de l’air du temps. Qu’on en juge : une jeune femme, Laura, jadis abordée alors qu’elle n’était encore que lycéenne pour travailler dans la mode puis pour poser de manière nettement plus dévêtue, revient chez elle, dans une ville de la côte bretonne, sans doute pour y entamer une nouvelle vie. Laura maintenant adulte recherche donc un logement et un travail. Sur les conseils de son père, ancien boxeur voulant remonter sur le ring mais également chauffeur attitré du maire de la ville, sa fille va solliciter l’édile, Quentin Le Bars. S’ensuit alors une triste histoire d’emprise entre une fille réputée légère et l’élu évidemment soucieux de sa popularité mais qui l’appelle dès que l’envie l’en prend (stricto sensu, cette « fille qu’on appelle » est une call girl). Bien entendu, le maire ne tiendra jamais ses promesses - il n’en a jamais eu l’intention -, et bien entendu également, elle consent sans vraiment faire de difficultés à tout ce qu’il lui demande. Mais Tanguy Viel, qui dans ce roman comme dans ses précédents sait jouer avec les situations stéréotypées, n’a pas son pareil pour restituer à ses personnages toute l’épaisseur nécessaire. À plusieurs reprises, il montre comment cette jeune femme pense pouvoir se sauver en se montrant malgré tout lucide sur leur relation, comment elle relance même au besoin son « amant » quand celui-ci ne pense plus à elle, à Paris où il a été nommé ministre de la Mer. Mais, observe le bras droit du maire, le directeur du casino Franck Bellec, « ne pas être dupe n’a jamais suffi dans la vie pour ne pas céder » et la peinture que l’écrivain fait de cette Laura moins couronnée de lauriers qu’elle ne le voudrait, moins clairvoyante sur les manipulations dont elle est l’objet qu’elle ne l’espérerait, est aussi convaincante que celle de cet homme plus soumis qu’il n’en a conscience à son désir brutal, bestial… C’est son art de la saisie des voix qui permet à Tanguy Viel de nous en convaincre car La fille qu’on appelle, c’est entre autres cela : des voix qui s’élèvent et se croisent pour tisser ce texte d’une formidable force de persuasion… Ainsi, dans la deuxième partie, le narrateur n’hésite-t-il plus à pénétrer au sein d’un même chapitre dans les différentes façons de voir de plusieurs personnages. Les phrases, quand la situation devient cruciale, s’allongent, plongent, s’enfoncent dans la logique heurtée des acteurs du drame, adoptent le ton particulier qui est le leur, leur façon d’appréhender les événements, de ne pas dire, non plus, quand ce n’est pas possible, et c’est saisissant. Ainsi, par exemple, le dernier chapitre, celui du dénouement, relate-t-il une même scène en faisant se relayer les voix narratives des différents protagonistes les unes après les autres, chacun s’exprimant avec ses mots, ses métaphores, sa logique, ses intérêts. Le lieu décrit, un quai du port un jour d’inauguration, devient successivement une scène de théâtre aux yeux de Bellec, le directeur du casino, un ring pour le boxeur Max Le Corre, le père de Laura, une arène selon sa fille qui se voit peut-être en victime sacrificielle et une forteresse pour Quentin Le Bars revenu dans sa ville défendre son honneur… c’est étourdissant ! Or cela vient couronner une narration qui, dans la première partie, rapportait les faits selon un point de vue unique, celui de Laura. Le lecteur sait toujours très bien où il en est, qui est la victime, qui est le bourreau mais ce régime hybride de la narration permet de mettre en évidence toute la troublante complexité des relations humaines...
Parce que ses ouvrages sont publiés chez Minuit, éditeur historique du Nouveau Roman, on a souvent affirmé de Tanguy Viel qu’il en était l’héritier. Certes, dans ses premiers livres les jeux avec les codes du polar (Le Black-Note, L’Absolue perfection du crime, Insoupçonnable), la narration cinématographique (Cinéma) ou les stéréotypes du roman américain (La Disparition de Jim Sullivan) étaient ainsi faits que le lecteur pouvait toujours percevoir une distance ironique, critique par rapport à « l’intrigue ». On y soupçonnait une volonté de l’auteur de pointer les embarras de la fiction telle qu’elle s’écrit chez les Modernes. Pourtant avec Paris-Brest, Article 353 du code pénal et maintenant La Fille qu’on appelle, faisant tous trois référence à la préfecture du Finistère, le lecteur assiste à un retour du Réel[1] sous le signe du social et du féminisme. Plus encore, ce retour du réel, et c’est peut-être la grande force de ce texte, s’opère dans ce récit grâce au recours discret mais constant à la tragédie. Outre la présence d’un homme de grand pouvoir, le ministre de la Mer Quentin Le Bars, ce qui confirme cette intuition, c’est l’aspect rétrospectif du récit. Dans la première des deux parties du roman, Laura, qui s’est décidée à porter plainte, à « balancer son porc » si l’on veut, fait sa déposition à deux policiers et cette déposition, relation rétrospective, a toutes les apparences d’un enchaînement inéluctable des faits, d’une fatalité en somme. Les dieux ou, en tout cas, ce qui en tient lieu dans notre société, sont là également, tel Neptune qui désigne ici le casino au bord de la mer, et où se retrouvent ceux qui décident, les notables de la ville. Il y a cette femme aussi, dont le nom n’est pas sans évoquer les malheurs des Grecs et des Troyens, Hélène, sœur du directeur de l’établissement, Franck Bellec, qui y tient le bar avec des airs de « pute princière » et pour laquelle le père de Laura avait jadis quitté sa femme. Il y a les vagues qui s’affalent sur la plage, encore, « comme un coryphée antique », « une assemblée tenue par cinquante naïades qui psalmodiaient autour d’elle : Oh qu’as-tu fait Laura ? Qu’as-tu fait ? ». Et l’héroïne qui est peut-être une catin mais qui est peut-être aussi un destin, celui qu’incarne une fille au « prénom moins mythique que Lachésis ou Clotho » mais qui tient dans ses mains « les mêmes ciseaux aiguisés qu’elle menaçait maintenant, sans le savoir, de refermer sur le fil ténu », n’a-t-elle pas ce pouvoir de mettre fin à la carrière de l’élu et maintenant ministre, Quentin Le Bars, comme une moire d’aujourd’hui ? Les prénoms et les noms indiquent volontiers, parfois dans l’ironie, le destin des personnages : Max Le Corre, par exemple, boxeur sur le retour, qui dans le dernier chapitre veut laver son honneur sali par le ministre avec ses poings, possède un nom signifiant, si l’on recourt au latin et au breton, « le plus grand nain ».
L’intérêt de ce détour par la tragédie n’est pas ici d’établir à nouveau une distance amusée ou cérébrale avec la narration. Au contraire, l’auteur suggère partout, dans la description de la mairie aménagée à l’intérieur de l’ancienne forteresse, dans l’aspect imposant du bureau d’un élu au travail, dans la façon dont il est entouré par des hommes en noir, dans les ors de la République et les armoiries de la ville, non pas que ces forfaits étaient commis autrefois aussi mais au contraire que rien n’a changé depuis le Moyen Âge ou l’époque d’Homère, que rien n’a réellement évolué et que cela a toujours lieu dans nos démocraties, même si cela revêt des modalités différentes. Les réflexes des foules sont toujours des réflexes d’inféodés flattés qu’on leur tende une main, qu’on leur adresse un sourire, et ceux des puissants toujours des automatismes cyniques masquant à peine la brutalité de leur désir de domination. Les adoubements réciproques « en une sorte de vassalité tordue » entre puissants existaient dans l’Antiquité grecque et existent toujours aujourd’hui. Et il y a toujours des destins tout tracés, des Hélène convoitées, enlevées, des femmes victimes de la concupiscence des hommes, de leur fantasme de domination, et des humbles qui perdent. Cela donne à cette histoire d’emprise si manifestement inspirée par nos débats d’aujourd’hui un surcroît de puissance presque vertigineux.
[1] Signalons à ce propos l’excellent cahier que lui consacre la revue Europe dans sa livraison de septembre-octobre 2021 (n° 1109 – 1110).
Thierry Romagné
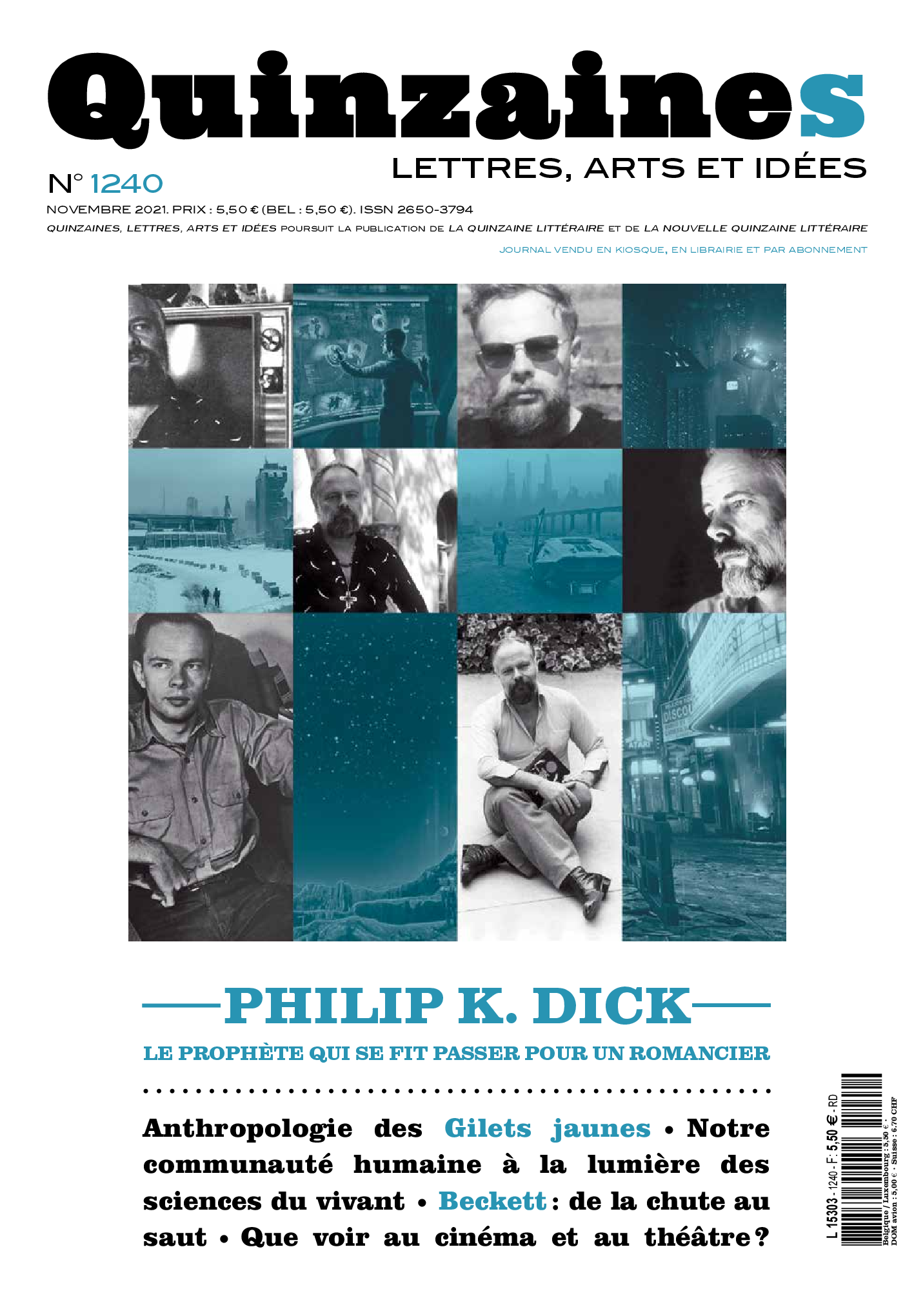

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)