On pénètre dans le nouvel ouvrage d’Éric Chevillard comme on entre dans une cage, après avoir tourné la page, poussé la porte, mais en souriant, sans crainte du danger, tout du moins d’un danger immédiat : nombreux sont ceux qui ont pu connaître, ne serait-ce que de réputation, les récits imprévisibles et drolatiques que l’auteur fait régulièrement paraître depuis la fin des années quatre-vingts. À l’intérieur de cette cage faite de pages, donc, s’ébattent et conversent, très librement d’ailleurs, dix-huit couples d’animaux, dix-huit courts textes qui se présentent tous de la même façon : un titre, qui est le nom de l’espèce animale dont il sera question dans les lignes qui suivent, et un dialogue entre « elle » et « lui ». Auparavant, une phrase ou deux d’introduction, en italique, et qui font tout de suite penser à des didascalies, ont précisé le lieu, la façon dont les protagonistes bougent, comment ils articulent leurs propos. L’ensemble a l’apparence d’un recueil de saynètes, de petites pièces de théâtre, légères et bon enfant. Fonctionne de la même façon, quoique sur un autre mode, la quinzaine de collages du complice de longue date de l’auteur, l’artiste Philippe Favier. Cernés d’un trait noir dont le tracé rectangulaire suggère lui aussi une cage, ils nous laissent voir de drôles de bestioles. Ils émaillent le texte de formes mi-animales mi-végétales aux concrétions inattendues, aux pédoncules s’achevant en gouttes, en yeux, aux membranes aux contours aussi capricieux que les coquillages que l’on aperçoit parfois accrochés ici, flottant là dans le blanc de la page. Les chiffres qui auréolent ces organismes, le nom de l’animal inscrit au-dessus de la vignette confèrent à cette ménagerie imagée le statut d’une rêverie scientifique un peu surannée, déconcertante, amusante à sa façon, qui n’est pas celle de l’écrivain mais qui la rejoint comme naturellement.
Les bêtes du texte se montrent très souvent spirituelles, usant d’une malice qui, si l’on ose dire, fait mouche. Ainsi de l’éléphant par exemple, qui s’interroge sur le sens de son existence, ce à quoi il sert, ou qui il sert : « Il nous suffit d’être, c’est déjà énorme », conclut cette masse de six tonnes, douze avec sa compagne ! Et ce sont toutes ces conversations animales qui étincellent de la sorte, entre ironie sans méchanceté et traits d’esprit rapides, propageant un humour fin, aérien, étincelant.
Qui sont ces bêtes, au juste ? Tout lecteur de bestiaires sait qu’à un moment ou à un autre, il lui faudra faire le décompte des animaux présents dans l’ouvrage et de ceux qui en ont été écartés, ainsi que des raisons qui ont présidé à ce tri : la religion, la morale, la science, la curiosité… Ici, il s’agit pour l’essentiel de mammifères, mais on croise également des reptiles tels le crocodile, le boa, la tortue, ou des oiseaux comme le flamant rose ou le perroquet. Tous sont des animaux que l’on peut effectivement rencontrer dans les zoos. Mais la cause de leur réunion dans ce livre, outre l’humeur de l’auteur, ce sont les maux de l’humanité dont ces espèces lui semblent être les symptômes visibles et audibles et qu’il évoque à sa manière – malicieuse, certes, pour éviter l’esprit de lourdeur dont parlait Nietzsche, mais aussi délicate et grave. Ainsi n’est-il pas indifférent que le volume s’ouvre sur l’orang-outan, dont l’étymologie signifie « homme des forêts » en malais. L’homme ne descend peut-être pas du singe, ainsi que le rappelle plaisamment dans ce premier texte ce singe lui-même, mais il partage avec l’orang-outan, qui se prend un peu trop pour un « Socrate contorsionniste » parfois, le goût de la réflexion quant à sa place dans le monde. Les suricates sont des boules d’anxiété au débit saccadé provoquant leur propre frayeur en la verbalisant, les girafes étirent leur cou dans un désir d’échapper à une prison terrestre qui n’est pas sans rappeler les conceptions néoplatoniciennes du corps humain. Les pandas, pour leur part, préfèrent se laisser mourir plutôt que de se reproduire tant la pression exercée sur eux pour qu’ils mettent au monde des petits leur semble insupportable, sans parler des ours souffrant du réchauffement climatique ou de la lionne qui aimerait bien que son machiste de mari se charge un peu plus de trouver la nourriture. Les zébus et les flamants roses quant à eux rencontrent de drôles de problèmes d’identité. Les flamants, étant tous tout roses, trouvent qu’ils se ressemblent trop, « à croire que la noirceur [leur] est interdite, et l’ironie » tandis que les zébus, qui aimeraient qu’on vienne les admirer, peinent à trouver leur « qualité différentielle » comme aurait dit Francis Ponge, quand ils se comparent aux vaches pour le pis, aux chameaux pour la bosse, aux buffles pour les cornes. La femelle tout à coup a pourtant une illumination : elle veut être estimée pour son âme. « Je ne veux pas être aimée pour mon corps. Je veux qu’on s’intéresse vraiment à moi », avant de réfléchir que la chamelle, qui possède déjà une bosse de plus qu’elle, dispose peut-être également de deux âmes… Il faudrait aussi évoquer les sentiments des lésulas, singes nouvellement découverts en 2012 au Congo. Ceux-là ont l’impression d’être le singe en trop. « Lui » doute du bien-fondé de leur existence : est-il autre chose qu’un « pléonasme de babouin » ? Il faut pousser si loin les analyses sanguines pour les distinguer de leurs cousins, les autres cercopithèques, qu’il est en droit de s’interroger sur son « idiosyncrasie ». Et nous lecteurs, qu’est-ce qui nous distingue d’eux, finalement ?
Il arrive parfois que l’on réponde à cette question en affirmant qu’il ne manque aux animaux que la parole. Or non seulement les bêtes de Chevillard possèdent cette parole, mais ces dernières partagent même avec certains d’entre nous un vrai souci de la langue. Outre l’hilarante saynète des perroquets où ces curieux volatiles ne font que prouver leur psittacisme en enfilant les lieux communs, nous croisons des tapirs redoutant d’être phonétiquement confondus avec des tamanoirs, qui commencent et terminent leur nom de la même façon qu’eux. Et quand la femelle demande au crocodile s’il a déjà mangé du gnou, celui-ci répond presque poétiquement que « rien qu’à l’évoquer, j’ai ma douleur aux maxillaires qui se réveille, toutes mes caries qui crient… gnou, gnou… manque un genou… même le mot colle aux dents… » faisant ici la démonstration d’une sensibilité langagière du meilleur effet, proférée par une gueule aussi raffinée qu’effilée…
On le voit, ces animaux-là nous tendent un plaisant miroir de notre propre stress, de nos vanités ridicules, de nos angoisses irrationnelles, millénaristes ou mortifères. Rien que cela suffirait à faire de Zoologiques un livre salubre et salutaire, somme toute d’utilité publique, le livre d’un moraliste d’aujourd’hui, dans la lignée de La Fontaine, bien sûr, mais aussi de La Bruyère et de tous les autres écrivains de même poil, à la fois aimables et lucides sur l’être humain. Mais la surprise de cet ouvrage réside dans le fait qu’Éric Chevillard a conscience du fait que pour qu’il y ait zoo, il faut obligatoirement qu’il y ait une présence humaine. Et si l’écrivain ne leur consacre pas un des dix-huit chapitres, les hommes en tant que personnages ne sont pas oubliés dans ce bestiaire de notre époque. Zoologiques est aussi, à sa façon, un discours sur les zoos, et c’est l’autre sens du titre. L’espèce humaine aussi est une espèce « vivante, mobile, dotée du souffle vital » (sens de l’étymologie latine d’animalis). Alors pourquoi s’arroge-t-elle le droit de mettre ses presque frères en cage ? Sous des couverts souriants, c’est le brutal arbitraire de l’être humain tenant enfermés dans un zoo des êtres vivants aux interrogations si proches des nôtres qui est pointé dans Zoologiques. Certaines de ces bestioles, nées en captivité, connaissent-elles de la vie sauvage autre chose que ce que leur en apprennent les documentaires de la télévision ? L’homme dans Zoologiques est celui qui considère que tout le règne animal est là pour le servir, pour le divertir. Cela suffit-il pour fonder sa supériorité ? Dans le dernier texte, les chauves-souris expriment très nettement que si elles font horreur aux bipèdes chevelus que nous sommes, c’est parce que nous n’avons « jamais rien su tirer [d’elles], ni beurre ni viande, ni fourrure ni drap. Ni trille mélodieux dans leur haie. » Et puis ces visiteurs qui regardent des bêtes tels les tapirs en les prenant pour des tamanoirs savent-ils seulement lire l’écriteau qui les présente ou sont-ils… analphabètes ? Les êtres humains ne regardent-ils pas, parfois, les animaux en se tordant le nez avec des grimaces plus disgracieuses que les faces animales dont ils rient ? À vrai dire, si les hommes visitent les zoos, c’est pour se divertir de leurs propres haines, estime le grizzly. L’énorme éléphant, quant à lui, sait ce qui fascine les êtres humains dans les animaux : « Nous représentons la permanence. Ce qui échappe aux évolutions, aux changements qui forment la trame de leurs existences harassantes. Contrairement à eux, nous sommes satisfaits de ce que nous sommes. » Pire, si l’on veut dire : Éric Chevillard voit, via la chauve-souris, l’homme comme un être incapable de s’orienter dans la nuit, un sens en moins puisque ne possédant pas de radar. Et, ajoute-t-il avec un accent qui rappelle le libertinage philosophique du XVIIe siècle, celui de Théophile de Viau par exemple, ne disposant pas de ce fameux radar, les êtres humains sont « un peu perdus » dans la nuit, « emplis de craintes insensées », « comme s’ils étaient entrés dans la mort déjà », ces « tueurs de l’ombre », comme les baptise la dernière ligne du texte…
N’allons pas trop loin, toutefois. Malgré le sérieux du propos, c’est toujours le rire qui l’emporte dans ce bel ouvrage. Les jeux de mots sont permanents, les boutades fusent, le second degré affleure partout et l’humour est de toutes les réflexions… Zoologiques et ses dix-huit saynètes forment avant tout une comédie, et une comédie qui nous met de bonne humeur. Mais comme d’autres comédies, ce petit livre a très probablement aussi pour but de corriger nos mœurs par le rire. Si possible.
Thierry Romagné
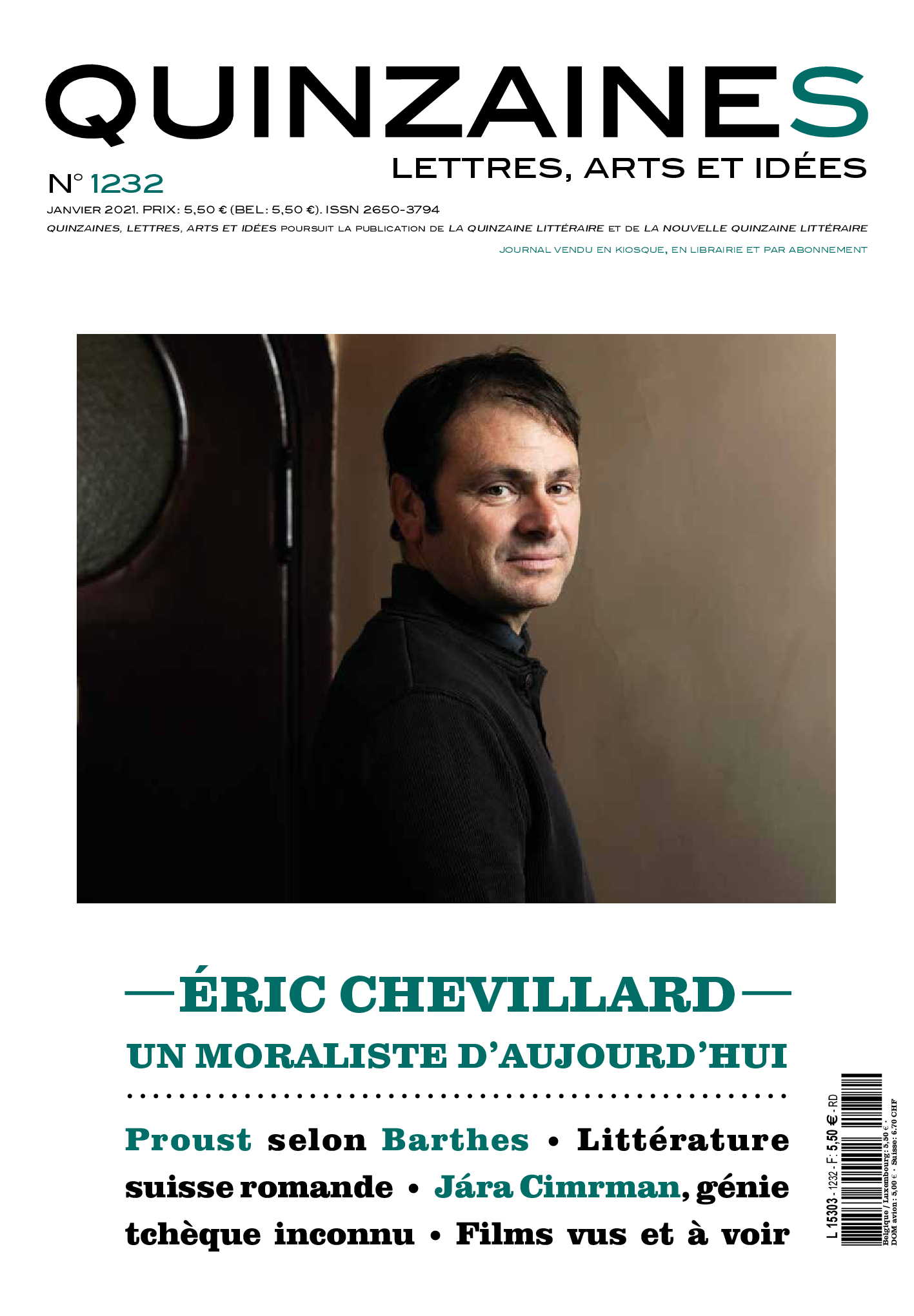

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)