Lire Simenon, se plonger dans le « magma » de son œuvre époustouflante et démesurée, s’apparente à une ivresse. On se laisse emporter, pris par une sorte de stupeur, de fascination. On admire, sans trop savoir pourquoi le plus souvent. On lit ces œuvres en ayant le goût de ne pas finir. Simenon fait partie des écrivains qui accompagnent la vie entière.
Il y a quelque chose d’hypnotique dans ces romans, qui ont trop longtemps pâti d’un malentendu que l’incroyable prolixité de l’écrivain a entretenu et qui aujourd’hui se révèle nettement. Des titres, des intrigues reviennent à la surface au gré de notre mémoire – Les Volets verts, Pedigree, La neige était sale, En cas de malheur, Le Fou de Bergerac, L’Homme de Londres, Les Fantômes du chapelier, Maigret se trompe, L’Affaire Saint-Fiacre, Le Testament Donadieu, Le Voyageur de la Toussaint, Le Locataire, Long cours, Feux rouges, Le Bourgmestre de Furnes, L’Assassin, Le Passager du Polarlys, Les Fiançailles de M. Hire, Bergelon, L’Évadé, Le Clan des Ostendais, Les Anneaux de Bicêtre, Trois chambres à Manhattan… Chacun élit ceux qui le troublent le plus, l’intriguent, lui font retrouver quelque chose de lui-même. Comme pour Conrad, Melville, Lowry, Cossery, Duras même, Simenon est un écrivain qu’on lit dans la connivence d’un cercle, d’une communauté, d’une famille de lecteurs. Quand on l’aime, qu’on en a le goût âpre et singulier, on ne peut plus le lâcher. Parmi ses admirateurs, on retiendra Max Jacob, Henry Miller, Marcel Aymé et Gide, Modiano et Narcejac ; ses contempteurs : Paulhan en tête, suivi de Nizan ou d’Angelo Rinaldi.
Passons vite sur le procès contre Simenon, les reproches qu’on lui a faits – d’être trop populaire, de trop produire, d’être un écrivain de genre, de faire toujours la même chose, de n’avoir pas de vision ou d’idées… –, qui trop longtemps ont faussé sa réception et accentué de vains débats qui se concentrèrent avec un certain ridicule au moment de son entrée dans la Pléiade (trois volumes lui sont consacrés !). Et concentrons-nous sur ce que la grande famille diverse de ses lecteurs – chercheurs et écrivains – peut en dire aujourd’hui avec un certain « recul ». Faire le bilan critique et réceptif d’une telle somme, en si peu de pages, ressortit à une gageure. On achoppe aux limites d’une approche synthétique et encyclopédique qui ne satisfait ni le fin connaisseur ni le néophyte simplement curieux. Le livre en porte le poids, tantôt passionnant, tantôt un peu vétilleux…
Il faut être ici irréductiblement du côté du lecteur. Et du lecteur qui a gardé une forme de naïveté, qui se laisse un peu faire, accepte de ne pas tout comprendre. Simenon est un écrivain qui séduit. On ne peut qu’être d’accord avec ce que répond Jacques De Decker lorsqu’il confie l’enchantement d’une lecture qui échappe : « Je suis incapable de lire Simenon de façon clinique. Cela fait partie des immenses qualités du romancier : ses livres résistent à l’acuité de regard du lecteur professionnel. » Quelle joie qu’il l’admette, le revendique ! À l’instar de quelques-uns dans ce volume qui disent leur affection irraisonnée pour le grand écrivain liégeois, qui ne se comprend bien que dans son rapport à l’enfance, à cette ville, à certains de ceux qui en peuplent les recoins embrumés… Roegiers, avec sa verve baroque habituelle, le qualifie d’« Hemingway wallon ». Pour lui, il « est proprement l’enfant de ce pays sans langue. Il s’en invente une très moderne, neutre, étale, sobre et juste ». Un peu plus loin, De Decker insiste sur l’un des points majeurs dont s’occupe ce volume, la question du style : « Il dit toujours les choses de la façon la plus exacte possible, en recourant à de maigres moyens. Et cette absence de complaisance, d’afféterie, de joliesse me fascine… »
Souvenons-nous de ces mots de Simenon : « Je m’efforce, à chacun de mes romans, de connaître un peu mieux l’homme et de créer, avec des moyens toujours plus simples, moins “littéraires”, des personnages plus vrais et plus complexes. C’est un peu comme envoyer des spoutniks vers l’infini. On sait qu’on n’atteindra jamais celui-ci mais on ne s’obstine pas moins à aller, chaque fois, un peu plus loin. » On peut lire dans ces propos à la fois l’obsession stylistique de l’écrivain, sur laquelle de nombreux contributeurs reviennent, et quelque chose sur l’apparente « homogénéité » que le volume contredit avec une clarté nécessaire. On ne peut penser à Simenon sans réfléchir à ce que c’est qu’être écrivain, à la douleur et l’euphorie qui en procèdent. Selon lui, « les romanciers sont des monstres qui, souffrant, se contorsionnant, se gonflant, suant des heures, des jours, des mois durant pour se mettre en transe, s’efforcent à leur tour de créer un monde, au risque d’éclater eux-mêmes, et de le porter à bout de bras ». C’est bien une aventure douloureuse. Simenon est décidément blessé, fragile, un peu honteux en même temps que faraud. C’est un écrivain et un homme paradoxal, ou inversement. Plusieurs articles ici insistent avec brio sur des questions psychanalytiques importantes – on pensera à ceux de Fourcaut ou de Mercier, à ce qui se dit de la transe, du rapport aux « femelles » ; l’amour, la sensualité, l’érotisme masqué, la pulsion…
Autant d’interventions souvent savantes et convaincantes qui peinent à dissimuler une certaine pesanteur dans la composition du volume. Ainsi, il faudra le lire dans le désordre plutôt que d’en suivre le cheminement très classique, que ne viennent troubler que les extraits d’un long entretien de Simenon avec Piron et Sacré ou des textes critiques plus anciens, dont ceux, remarquables, de Roger Nimier (1954) et de Maurice Nadeau (1946), ou, plus discutables, de Brasillach ou de Nourissier… La lecture de l’ensemble va d’ailleurs crescendo, disons-le clairement. Plus on avance, plus on s’amuse, se délecte. Parfois on s’agace – à la lecture des premiers textes plus académiques, de la glose peu convaincante des adaptations télévisuelles, de l’entretien certes important avec Pivot mais qui s’abîme dans l’exhibition un peu gênante d’une fragilité humaine, ou lorsque Philippe Delerm ou Philippe Claudel bavardent quelque peu. À d’autres lectures, on jubile – les pages de Tomasovic sur les relations de Simenon avec le cinéma, pleines d’une légèreté délicieuse, ce que Simenon en dit lui-même, celles de Narcejac (dont il faut relire le texte réédité au Castor astral), pleines d’intelligence, de Benoît Denis, l’éditeur de la Pléiade et du « Voyager avec » à l’iconographie remarquable, les réponses longues et riches de Christine Montalbetti, celles de Carrère ou de Toussaint. Chacun trouvera des morceaux de choix qui résonneront avec ses lectures propres, ses émotions vives, y partagera une grande joie de lecteur. Quelques inédits de valeur inégale émaillent le recueil avec plus ou moins de bonheur, comme des extraits de correspondance (Miller touchant, tout comme Jacob, Gide essentiel, Cocteau superflu, Fellini accessoire…).
Mais ce sont des détails. Il ressort de la lecture de ces textes hétéroclites le caractère singulier du travail épuisant de Simenon, ses capacités d’observation, d’empathie et de cruauté revigorantes, d’obstination aussi, sa dimension atypique, sa faculté d’invention qui semble inépuisable. Nimier écrit que Simenon « sait sentir les événements par le dedans, les pénétrer par la sympathie, se mettre dans la peau des autres », semblant redoubler l’auteur lui-même qui disait, bourrelé d’inquiétudes, « se mettre dans la peau des autres, vivre indirectement la vie des autres, souffrir les souffrances des autres, se réjouir des réjouissances des autres ». Ajoutant un peu plus loin que « ce Balzac veule, cet Eugène Sue désespéré, est à la mesure de l’époque. Il a pris ses lecteurs comme personnages ». C’est peut-être l’aspect le plus réussi de ce livre que de montrer, à travers une multitude de voix, depuis des univers fort différents, que ce sont les lecteurs qui font cette œuvre-là, qui l’instaurent, la font vivre, la retournent sans cesse. En témoignent les courriers de lecteurs qu’étudie Véronique Rohrbach. Ainsi, un étudiant lui écrivait en 1965 : « Vous m’avez donné, au travers de vos textes, le goût de l’humain, un certain sens de l’amour des hommes. Vous m’avez révélé une nouvelle façon de les regarder, une raison de mieux les connaître, de davantage leur pardonner, en les comprenant mieux. »
Lire ce Cahier revient à recevoir, par l’intermédiaire des lecteurs, sans afféterie, sans grand discours, sans théorie ou position de principe, ce que peut être le roman, ce qu’il porte de nous tous. Nous ne pouvons qu’être d’accord avec Jean-Baptiste Baronian : « C’est prodigieux. C’est unique. C’est le roman à l’état pur. C’est le roman au paroxysme de la perfection romanesque. C’est le roman idéal. C’est le génie du roman dans tous ses états. » Il faut, décidément, y aller voir de plus près.
Hugo Pradelle
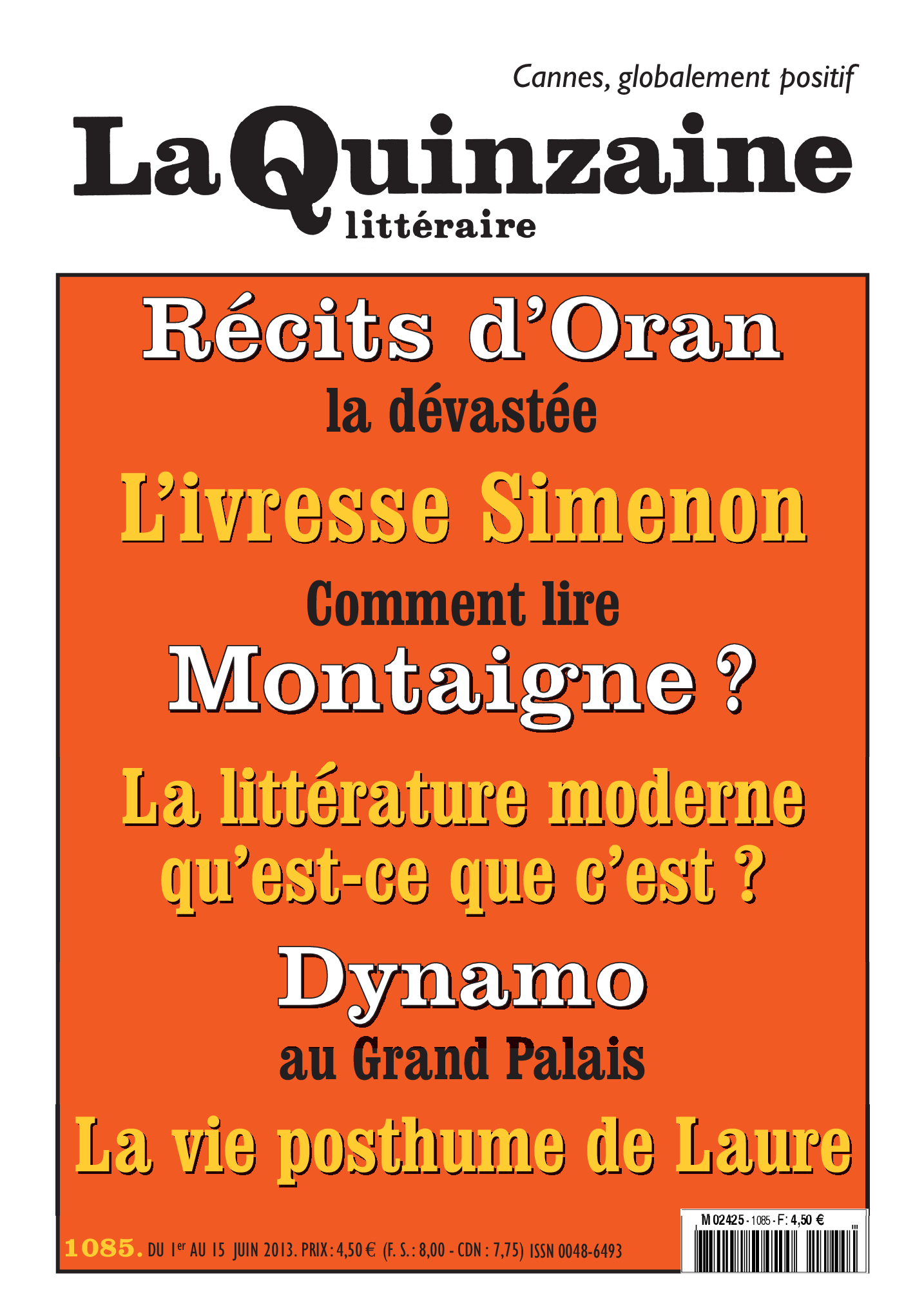

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)