Le livre raconte pourtant une histoire assez simple qui pourrait s’apparenter à un « fait divers » (Omar, un jeune arabe qui a sombré dans la délinquance, assassine celle qui avait été sa mère adoptive, Sidonie) ; mais dans cette histoire, on entend sourdre l’Histoire, la guerre, les guerres de 39-45, d’Algérie, en Yougoslavie, plus encore, des légendes, des mythes, si bien que la langue en devient épique, déborde le cadre réaliste du récit. Une autre explication est possible. Enfant de perdition est un roman d’éducation qui raconte en trois parties (Infantia, Pueritia, Adolesce...
Un roman nomade
Article publié dans le n°1224 (01 mars 2020) de Quinzaines
Enfant de perdition
(P.O.L.)

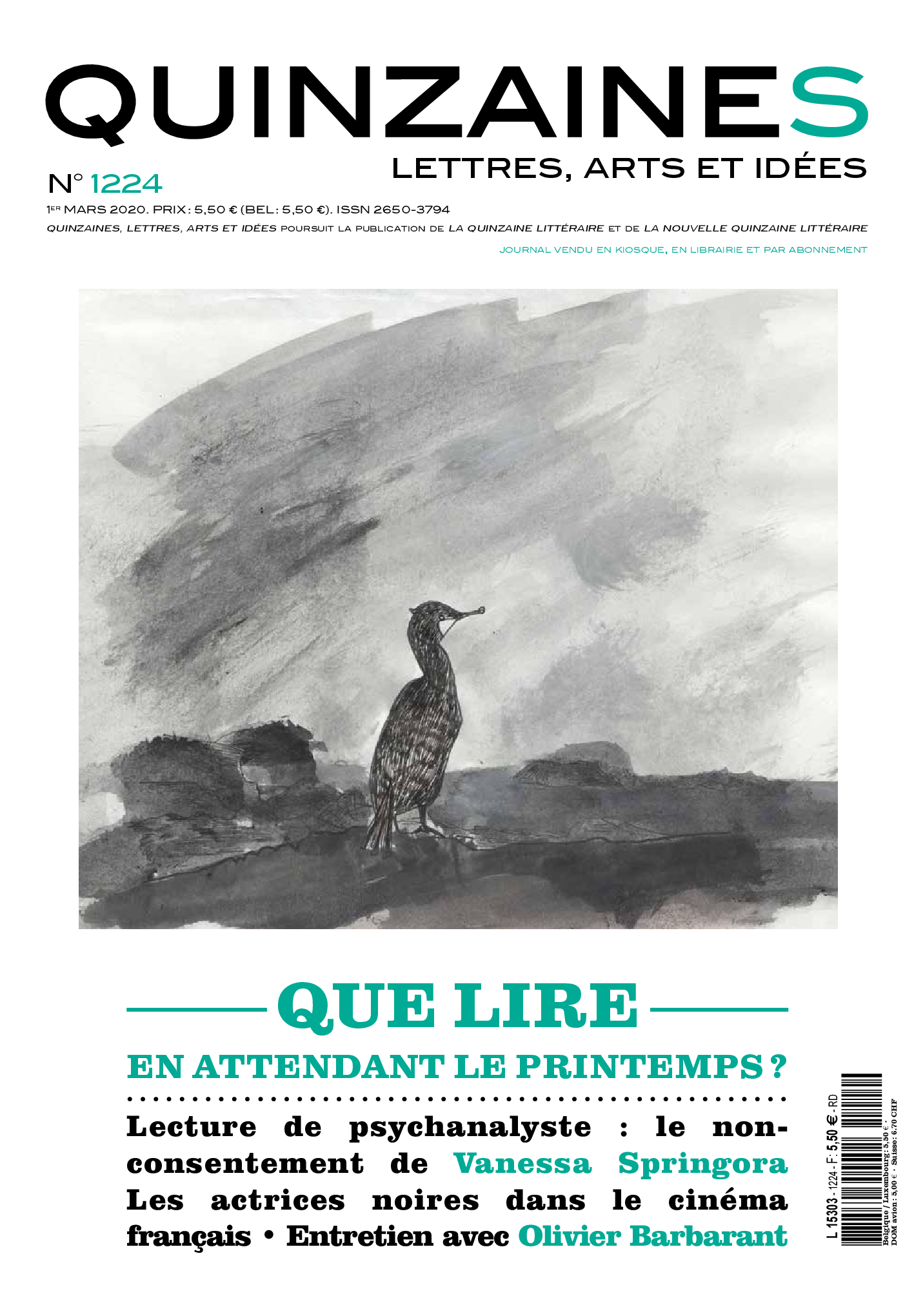

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)